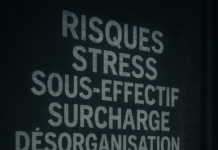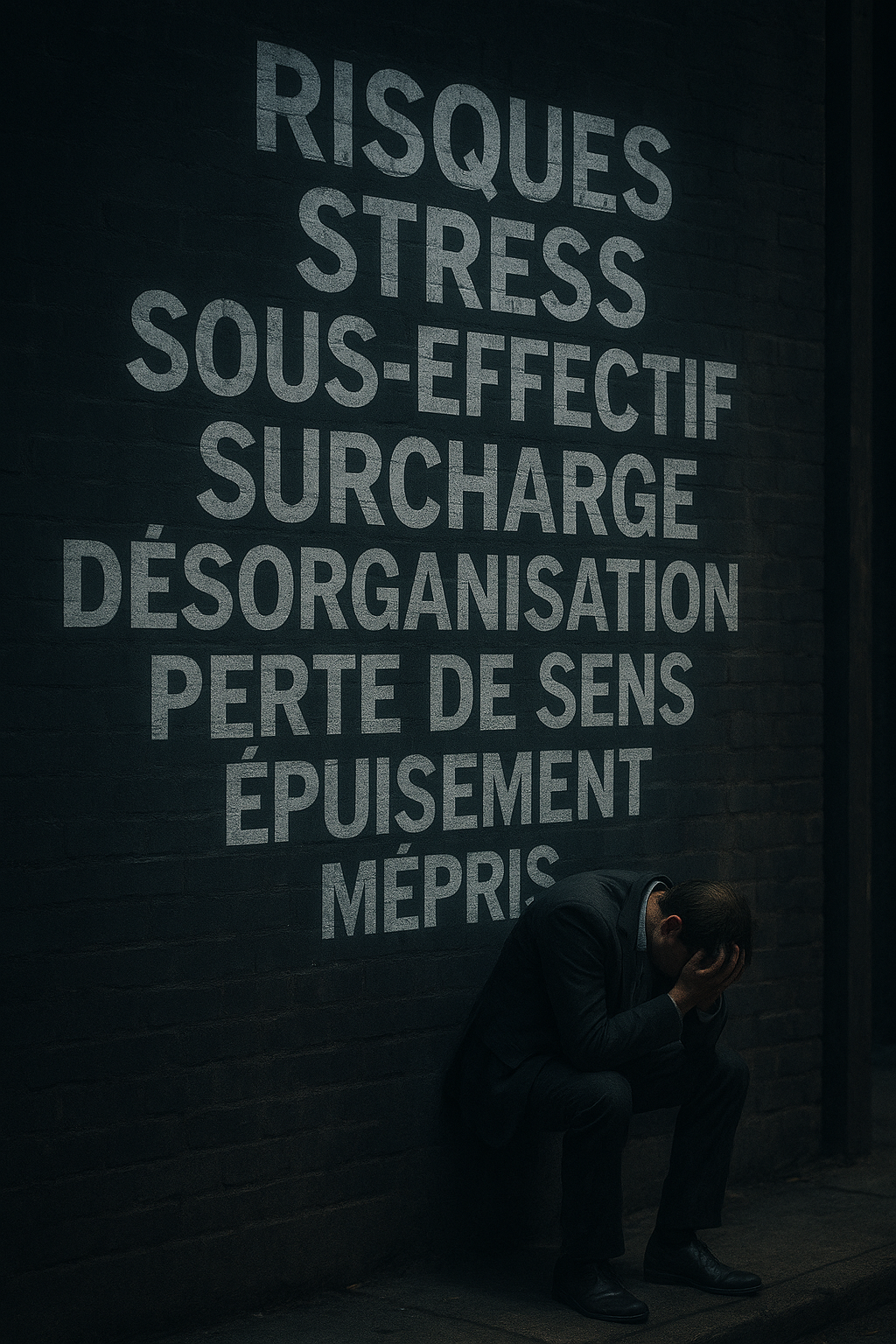Une note sans précédent, un signal d’urgence absolue
Pour la première fois, tous les chefs de brigade de la Police judiciaire genevoise ainsi que leurs remplaçants se sont unis pour écrire et signer une note adressée à la Direction de la police, avec copies au Département des Institutions et du Numérique (DIN), au Procureur général, à la direction de la Gendarmerie et à d’autres autorités clés.
Leur cri d’alarme est clair : la Police judiciaire est en train de s’effondrer.
« Cette situation, déjà tendue depuis plusieurs années, atteint aujourd’hui un seuil critique. »
Le cœur de leur message : des effectifs insuffisants, une charge de travail insoutenable, un moral en berne, une qualité de service en dégradation constante, un modèle de police à bout de souffle.
« Des enquêtes sacrifiées, en raison de la priorisation imposée par les conditions de travail difficiles. »
« Un accueil dégradé des victimes. »
« Une alerte préoccupante à la santé physique et psychologique des inspecteurs. »
Les chefs décrivent un quotidien rythmé par l’épuisement, la perte de sens et le découragement :
« Les horaires irréguliers, astreintes, pression judiciaire, confrontation à la souffrance, à la violence, à la mort… Malgré tout cela, la PJ continue de remplir sa mission avec engagement. »
En réalité, non, la PJ ne parvient plus à remplir sa mission !
Aujourd’hui, non seulement la Police judiciaire peine à assurer le tout-venant, mais plus grave encore, elle n’est plus en mesure d’effectuer du travail d’initiative. Le renseignement, ADN de notre service, s’amasse sans pouvoir être exploité.
Des victimes d’agressions sexuelles qui contactent la brigade des mœurs sont rappelées la semaine suivante pour convenir de rendez-vous, en raison du manque de personnel. Du jamais vu il y a quelques années encore, et des situations hélas de plus en plus fréquentes. Douloureux pour une victime en quête de justice, et un véritable crève-cœur pour des policiers investis.
La brigade financière, pourtant mieux dotée en effectifs que les autres brigades de la PJ, est submergée par les dossiers du Ministère public. Les armoires débordent de procédures en attente, et les informations transmises par d’autres services — notamment sur du blanchiment lié au trafic de stupéfiants ou au banditisme — restent inexploitées, faute de ressources.
La PJ, autrefois reconnue pour sa grande réactivité, doit désormais différer des opérations de police faute dedisponibilité des effectifs, quand elle ne doit pas tout simplement y renoncer.
Ce ne sont là que des exemples de dysfonctionnements parmi tant d’autres. Aucune brigade de la PJ n’échappe à la crise.
Encore plus préoccupant, nous en arrivons à nous demander si nous aurions les capacités à faire face à un événement majeur si ce dernier venait à se produire.
À cela s’ajoutent les nombreuses mobilisations de dernière minute pour des événements pourtant annoncés publiquement de longue date, bloquant congés et vacances, sans raison concrète ni information claire sur les horaires ou les missions… et sans compensation.
Aussi difficile qu’il soit de devoir l’admettre, nous sommes devenus une police « de beau temps » qui tient encore debout grâce à l’engagement sans faille de ses policiers, à un savoir-faire précieux, mais qui s’épuise inexorablement.
Et pourtant, cette fragilité s’installe dans un contexte qui, lui, n’a jamais été aussi instable, volatile, imprévisible et anxiogène. Les tensions sociales s’exacerbent, la violence augmente, les repères d’autorité s’effacent.
Alors que le besoin d’une police forte, rassurante, agile et présente n’a jamais été aussi évident, la police genevoise a perdu une partie de son rôle moteur. Elle n’est plus la référence qu’elle a longtemps été pour les autres polices cantonales. Elle a vu s’éroder plusieurs de ses pôles de compétence, faute de moyens, de vision et de considération.
Ce constat, aussi affligeant qu’inquiétant, est aujourd’hui partagé par l’ensemble de la Police judiciaire, hiérarchie incluse.
L’alerte chiffrée : une PJ exsangue
La crise actuelle ne date pas d’hier. Depuis des années, les syndicats alertent sur l’effondrement progressif des effectifs de terrain et la disparition de la filière de recrutement propre à la PJ.
« Notre service ne dispose plus de la possibilité de recruter et former ses propres effectifs. Il dépend désormais entièrement des transferts depuis la Gendarmerie. »
La Police judiciaire genevoise devrait disposer de 325 ETP (emplois temps plein), selon l’estimation faite par son propre état-major et ses chefs de brigade. Aujourd’hui, elle en compte seulement 290, soit 35 policiers manquants pour assurer ses missions.
« Le ratio actuel d’affectation à la sortie de formation – 18 aspirants projetés à la PJ contre 181 à la Gendarmerie de 2025 à 2028, soit moins de 10 % des aspirants – est profondément déséquilibré. »
Un service pourtant indispensable
La Police judiciaire n’est pas un service comme un autre. Elle constitue une colonne vertébrale de l’appareil sécuritaire genevois, dédiée au traitement des affaires les plus sensibles, les plus graves, les plus complexes : homicides, agressions, brigandages, violences sexuelles, criminalité organisée, cybercriminalité, lutte contre le trafic de stupéfiants, délinquance juvénile, disparitions inquiétantes, négociations de crise, police technique et scientifique, infiltrations d’organisations criminelles, traque des fugitifs, auditions d’enfants victimes d’infractions graves, violences intrafamiliales, filatures et interpellations d’individus dangereux…
Elle agit au service direct de la justice, des victimes et de la société. Son efficacité conditionne la qualité des enquêtes, la poursuite des auteurs et la protection des plus vulnérables. Elle est ainsi un des acteurs de la cohésion sociale de notre canton.
« L’expertise, la rigueur, l’investissement et le professionnalisme de la PJ sont essentiels pour garantir des enquêtes solides et un traitement équitable des infractions pénales. »
Fragiliser la PJ, c’est fragiliser toute la chaîne pénale. Et en bout de course, exposer davantage les citoyens.
Sans la Police judiciaire genevoise, pas d’interpellation d’auteurs de séquestrations à domicile, pas d’identification de violeurs, pas d’arrestation du poseur de bombes en série.
Aujourd’hui, c’est précisément l’efficacité de ce service qui fut pourtant d’excellence, qui est gravement menacée.
Cette érosion de la Police judiciaire n’est pas le fait de son état-major, ni de son chef. Elle résulte d’un dysfonctionnement structurel plus large, qui touche l’ensemble de l’organisation policière. Et la PJ est loin d’être la seule à en subir les conséquences.
Une Gendarmerie elle aussi à bout
Nos camarades gendarmes ne sont pas épargnés. Eux aussi souffrent d’un sous-effectif chronique.
Ils ne peuvent plus assurer le socle sécuritaire. Ils ne parviennent plus à répondre à tous les appels, ni à garantir une présence suffisante sur le terrain. Ils sont sans cesse rappelés en congé. Fatigués, démoralisés. Ce n’est plus admissible.
Le nombre de policiers malades ou absents augmente fortement, en PJ comme en Gendarmerie, reflet d’un mal-être profond, qui alourdit encore la charge de ceux qui tiennent bon. Une souffrance longtemps aggravée par une gestion RH calamiteuse. Un audit interne sur les ressources humaines a bien été mené, mais ses conclusions, pourtant attendues, n’ont jamais été rendues publiques.
Une dérive organisationnelle née en 2015… et prévisible
Les causes de cette dégradation sont connues. Et elles ne sont ni récentes, ni accidentelles.
La LPol votée en 2015, portée par Pierre Maudet, a profondément désorganisé la police genevoise.
À l’époque, les syndicats avaient averti. Ils ne se sont pas trompés.
Cette loi, adoptée à quelques voix près, a créé une machine rigide, cloisonnée, bureaucratique, centrée sur les gradés et non sur l’opérationnel.
Aux problèmes structurels et d’effectifs, est venu s’ajouter celui d’une formation unique des policiers, militaire, inadaptée et lacunaire.
La loi Maudet a ainsi donné naissance à un monstre maintenu en vie jusqu’ici par l’inertie, le manque de courage et l’absence totale de remise en question, tant du côté de l’Exécutif que de la Direction de la police.
Une réforme votée, sabotée, puis enterrée
La Direction de la police, qui avait soutenu la LPol de Pierre Maudet en 2015, a longtemps tout entrepris pour en masquer les effets destructeurs. Elle a ensuite tenté, avec l’appui de l’alors Conseiller d’État Mauro Poggia, d’empêcher le vote de la réforme en 2022. En vain.
Lassé de l’immobilisme du magistrat et des stratégies dilatoires, et soucieux de réparer les dégâts, le Grand Conseil a quand même voté la réforme de la LPol à une écrasante majorité, afin de redonner aux Genevois une police formée à Genève comme il se doit, une police décloisonnée, plus présente sur le terrain et donc plus performante.
Mais que s’est-il passé depuis ? Rien.
L’Exécutif et la Direction de la police sont parvenus à maintenir le modèle ancien, rebaptisé mais inchangé, celui-là même qui empêche une police proche de la population, réactive et présente là où on l’attend – et qui détruit la motivation des agents.
Résultat : malgré un vote démocratique clair, le retour à Genève de la formation des policiers a été reportée à 2029; l’organisation interne de la police est restée inchangée, et les dysfonctionnements se sont désormais aggravés et pérennisés.
Caprices coûteux en temps de crise
Désormais dans l’impossibilité de contester des problèmes devenus trop saillants pour être dissimulés, la Direction de la police et le Département refusent pourtant de remettre en question des choix structurels absurdes.
Est-il normal que des policiers de POLSEC (ou USECU), affectés aux urgences et secours, rappelés de leurs congés et incapables de répondre à toutes les réquisitions, voient leurs missions sacrifiées ?
Alors qu’on maintient des unités comme POLPROX (ou UPROX), qui ne peuvent pas appuyer leurs camarades et dont les missions doublonnent avec celles des polices municipales ?
Alors qu’on crée une brigade équestre, dont ni les missions ni l’utilité réelle ne sont comprises, en pleine crise de moyens humains ?
Alors que des policiers sont cantonnés à des tâches administratives ?
Est-il normal d’engager des cadres à l’externe, alors qu’il y a déjà pléthore à l’interne ?
Peut-on vraiment se permettre le luxe de la police d’apparat, pendant que la sécurité publique se désagrège ?
Dans ce contexte, le PLR a récemment déposé un projet de loi constitutionnelle visant à démanteler la POLPROX (ou UPROX) et à rendre aux communes les compétences en matière de police de proximité. Ce texte acte l’échec du modèle centralisé imposé par la LPol de Pierre Maudet et reconnaît la nécessité de clarifier les missions, mutualiser les moyens et renforcer l’efficacité de terrain.
Le SPJ soutiendra pleinement cette initiative, qui va dans le sens de ce que nous défendons depuis des années : une police recentrée sur ses priorités fondamentales, au service direct des citoyens et capable d’assurer ses missions sans s’épuiser.
Le SPJ appelle Mme Kast et la Direction de la police à prendre leurs responsabilités
En refusant de s’attaquer aux causes structurelles du malaise, et en ignorant les alertes répétées des policiers, le Département de Mme Kast et la Direction de la police ont fait le mauvais choix de l’inaction. Leur priorité ? Sauver la façade, quitte à laisser l’institution s’effondrer et les agents sombrer.
Ils affirment que la question des effectifs budgétaires relève du Législatif, mais refusent d’utiliser les marges de manœuvre internes prévues par la réforme. Ils auraient très bien pu, par exemple :
Mais ils ne l’ont pas fait jusqu’ici.
C’est pourquoi nous appelons une nouvelle fois Mme Kast et la Direction de la police à prendre enfin leurs responsabilitéset à corriger rapidement les erreurs du passé qui peuvent encore l’être.
Il n’est pas trop tard pour changer de cap. Et si cette volonté existe, le SPJ sera un partenaire constructif et pleinement engagé pour bâtir une police plus opérationnelle, plus ancrée dans le réel et au service direct de la population.
À défaut de mesures rapides et concrètes, le Grand Conseil devra, une fois encore, intervenir. Nous l’invitons dès à présent à rester vigilant et, si besoin, à rappeler à Mme Kast et à la Direction de la police qu’une loi votée doit être appliquée — pas travestie — surtout lorsque son détournement se fait au mépris des besoins et de la sécurité de la population.
C’est une condition indispensable pour que Genève retrouve la police d’excellence qu’elle a été, capable de relever les défis croissants avec rigueur, engagement et efficacité.
Parce que le bien-être de vos policiers est essentiel. Et parce que la sécurité publique ne peut plus attendre.